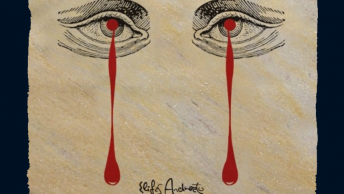LE DIVAN FAMILIAL – Revue de thérapie familiale psychanalytique, n. 44, Printemps 2020, p. 211-221
La famille perverse et l’inceste : du filicide au matricide psychique[1]
Face à l’abus sexuel intrafamilial, nous nous intéressons dans cet article à l’effet de la perversion et de la cruauté présentes dans le psychisme des parents ou de leurs substituts sur le psychisme des enfants ou d’un enfant en particulier et aux impasses qui en résultent pour traiter ces personnes par la psychanalyse. Face à des situations d’abus sexuel, il n’est pas rare que les victimes ne reçoivent pas de reconnaissance appropriée par rapport à ce qu’elles ont vécu ou vivent encore dans leur famille. Cette situation est conforme au déni et au silence familial, ce qui implique toujours le refus de savoir et l’expectative que, tout au long de la vie, rien ne soit enquêté ou interrogé concernant ce problème, en particulier lorsque le parent à qui la révélation a été faite, généralement la mère, dénie l’enfant, évite tout questionnement psychique et ne veut rien savoir. Annulé, l’enfant éprouve une expérience analogue à une tentative de meurtre, un filicide psychique, qui deviendra une source de colère, ce qui favorisera ce que l’on pourrait appeler un matricide psychique. De telles questions affectent la relation analysant-analyste lorsque la spécificité de ces expériences n’est pas prise en compte, ce qui peut rendre l’expérience psychanalytique inefficace, tout en répétant le déni, sans possibilité de transformation.
Parler de traumatismes «réels» peut conduire à croire qu’il y en aurait des fictifs ou des faux, mais ne pas en tenir compte serait ne pas comprendre leur importance et leurs effets qui, par leur nature et leur intensité, sont dévastateurs. L’ancienne polémique entre le fait objectivable et l’activité fantasmatique est donc reprise et il nous semble que l’erreur est de les opposer comme excluants, alors qu’ils devraient être considérés comme complémentaires: la brutalité traumatique, avec son effet dévastateur, qui renforce l’expérience de délaissement, et l’activité psychique associée au trauma et ce qui se passe ensuite. Lorsque le psychanalyste ne prend pas en compte le fait lui-même, quels effets cela aura-t-il sur l’analysant, en particulier lorsqu’il s’agit des processus intersubjectifs qui se déroulent entre eux pendant les séances et qui créent un champ intersubjectif unique et exclusif ?
On fait valoir que ce qui compte vraiment, c’est la réalité psychique, telle qu’elle est vécue par le sujet. Certes, cela en dit long, mais n’y aurait-il pas de différence quand l’enfant aura été victime d’abus et / ou de négligence de diverses manières et qu’il devra vivre avec ces expériences dans sa mémoire, sans que celles-ci ne soient partagées à juste titre, afin qu’elles puissent être symbolisées et élaborées? Après tout, il y a des choses de l’ordre de l’inimaginable pour un enfant, surtout à jeune âge: par exemple, collier thaïlandais introduit par le père dans l’anus du fils ou brosse à cirer les chaussures introduite par l’oncle maternel dans le vagin de la nièce, les deux enfants étant agés de 4 ans à l’époque. On peut considérer qu’un adulte qui arrive au cabinet en rapportant des faits similaires auxquels il a été soumis dans son enfance peut les avoir fantasmés et les rapporte comme une réalité vécue. C’est possible, mais serait-ce une règle? Si non, quel effet cette différence aura-t-elle sur son psychisme quand il raconte son expérience au psychanalyste et que celui-ci ne se rend pas dûment compte de la réalité des faits? Et en matière d’assistance psychanalytique d’enfants et d’adolescents? Y a-t-il un effet sur le déroulement du traitement si le psychanalyste donne ou pas de crédit à ces récits comme des expériences vécues? Nous le croyons, car l’expérience de la victime est très complexe et implique la perversion.
Le garçon susmentionné a eu deux saignements anaux à l’école, mais ce ne sera que par son dessin du Patolino fait pendant une séance diagnostique, que son histoire commencera à être racontée, car dans les fesses du personnage des balles ont été introduites – et cela sera discrédité par les assistants sociaux et par les psychologues, justement eux qui faisaient partie du système judiciaire ! Après tout, son père était PhD dans son domaine et l’oncle paternel, procureur de la justice. Comment cela pourrait-il se passer? En ce qui concerne la fillette, elle a eu une hémorragie sévère qui a entraîné une hospitalisation dans un centre de soins intensifs pendant deux mois. Malgré la brutalité indéniable à laquelle cette petite fille a éte soumise, la personne qui avait sa garde, sa grand-mère maternelle, disait que la coupure était si petite qu’on n’a même pas trouvé de cire à l’intérieur de son corps. L’enfant nous a été référée par un psychologue du système judiciaire qui voulait savoir s’il y avait des conditions permettant à l’oncle maternel – l’abuseur – de retourner à la maison et de vivre avec elle. Dans de telles circonstances, ni les conditions psychiques de l’agresseur, ni celles de l’environnement familial et les risques réels auxquels l’enfant pourrait être exposée, à la suite d’un tel retour n’étaient pas pris en compte. Il faut dire que toutes les situations qui se présentent à nous ne sont pas aussi brutales et mobilisatrices que celles-ci, mais elles causent toujours beaucoup d’inconfort et d’étonnement, de sorte que l’épouvante peut être proche du discrédit. De ce point-là à la dénégation, la distance est courte.
La dynamique familiale perverse
Il existe de nombreuses possibilités d’arrangements familiaux impliquant des situations d’abus sexuels au sein de la famille; nous abordons l’une d’entre elles, peut-être la plus commune, comme une ressource pour réfléchir à certains éléments. C’est la situation d’un père ou d’un beau-père abuseur de sa fille ou de sa belle-fille, disons de 7 à 11 ans. L’enfant peut se taire pour plusieurs raisons, mais celle qui entretient encore une relation de confiance avec sa mère en parle, et celle-ci, à son tour, commente avec son compagnon, qui dénie tout. Alors, la mère dénie l’enfant dont la confiance se perd. Dans le cas d’un beau-père, disons que le père biologique est absent ou vu par l’enfant comme inaccessible, alors, il ne sait rien. La situation abusive subsiste. Mais quels sont les enjeux?
L’enfant sait qu’il dit la vérité et que l’agresseur ment; l’agresseur sait qu’il ment, que l’enfant dit la vérité et sait qu’il ment. Ils savent tous les deux que la mère refuse d’y croire, soit parce que ce n’est pas commode pour elle d’admettre la vérité pour diverses raisons, soit parce qu’elle se réfugie dans une partie de son psychisme sans moyen de penser, ou même à cause de sa propre perversion en collusion. La vie familiale se poursuit comme si de rien n’était et, de l’extérieur, la famille ne sera pas nécessairement perçue comme dysfonctionnelle, alors que tout continue à se produire, car les abus sexuels dans la famille ont tendance à se poursuivre lorsque l’enfant est dénié. De plus, il est vu comme menteur quand il dit la vérité, se voyant disqualifié et démoralisé, vivant une véritable moquerie, et celui qui ment passe pour vrai et même pour lésé par des accusations déraisonnables et impertinentes. Ainsi, l’agresseur est innocenté et la victime, accusée. Tout est perverti. Nous considérons cette expérience comme un filicide psychique.
La famille perverse s’articule en deux facettes: l’une, celle des apparences extérieures, dans laquelle l’adaptation sociale et l’adaptation aux règles sont considérées; l’autre, celle de la réalité familiale, dans laquelle les valeurs propres à l’être humain socialement ajusté sont ignorées et subverties. On vit donc dans deux mondes. Bien que des dynamiques perverses se glissent de diverses manières dans les relations établies avec le milieu, puisqu’elles impliquent un régime psychique, un mode de pensée et un schéma de relation, elles ne sont pas toujours facilement reconnues.
Le domaine privilégié de la perversion est l’action relationnelle, caractérisée par des passages à l’acte au moyen de comportements manipulateurs qui favorisent la déstabilisation chez les autres, familiers ou non, en raison de la confusion et de l’angoisse induites par les dénis, les scissions et les identifications projectives. L’altérité est niée et les contacts sont caractérisés par des postures invasives alternant avec d’autres, séductrices et / ou dominatrices. La relation domination-soumission s’impose donc, mélangée à des perversions sexuelles et narcissiques.
Racamier (1987, 1989) présente la perversion narcissique comme étant l’inverse de la schizophrénie et qui se définit comme une organisation durable ou transitoire caractérisée par la nécessité, par la capacité et pour le plaisir de se mettre à l’abri des conflits internes, en particulier du deuil, afin de s’affirmer au détriment de l’environnement, en objet manipulé comme un ustensile, dont l’existence en soi n’est pas niée, mais est considérée comme n’ayant aucune valeur propre. L’auteur y voit une manœuvre antidépressive en ce qui concerne la perversité et souligne qu’il s’agit d’une perversion morale, qui n’implique pas nécessairement une perversion sexuelle, bien qu’elle ne l’écarte pas non plus. Son origine est la séduction narcissique mutuelle mère-bébé qui est éternisée comme moyen d’évasion aux vicissitudes pulsionnelles de l’ambivalence et du conflit œdipien. En se perpétuant, elle renforce l’antœdipe mal tempéré et aboutit à l’inceste ou à l’incestuel, ce qui correspond à ses équivalents. Racamier comprend que l’inceste, plus que sexuel, est une question narcissique.
Le fantasme prédominant du pervers narcissique est énoncé en ces termes, déclare Defontaine (2003: 55): «L’enfant-pour-toujours-et pour-toujours-irrésistible». Le pervers narcissique, ainsi que le pervers sexuel, n’a jamais pu renoncer à la séduction narcissique de façon à ne pas être confronté à l’angoisse de castration. La pensée perverse se caractérise par sa pauvreté, ainsi que par l’évitement de la vérité, puisque seuls les buts comptent.
Des familles qui s’articulent à partir de la conjoncture domination-soumission semblent chercher à perpétuer une séduction narcissique mutuelle et sont gouvernées par l’antœdipe mal tempéré et par l’incestuel, voire par l’inceste consommé (Racamier 1989, 1995). Elles se caractérisent par l’évitement du travail psychique, notamment en ce qui concerne le deuil, et par l’indifférenciation entre les êtres, les sexes et les générations. Dans cette condition, les figures parentales manquent de maturité psychique et constituent avec leurs enfants plutôt un groupe indifférencié qu’une famille proprement dite, régie justement sur l’altérité et la reconnaissance des différences. Cette situation peut encore être aggravée quand elle implique des désirs parentaux inavouables à l’égard du ou des enfants en croissance (Almeida-Prado, 2015).
La colère et la cruauté
La chose la plus choquante pour un enfant victime est peut-être le fait que sa mère est indifférente ou ne le croit pas quand il fait la révélation et que, par conséquent, ne le protège pas lorsqu’il dit la vérité sur la situation d’abus sexuel dans la famille. La mère en collusion perverse avec l’agresseur est une mère méchante. Si au début apparemment tout continue comme si rien ne s’était passé ou ne se passe pas encore, des dysfonctionnements surviennent dans différents domaines, toujours très débilitants, voire carrément destructeurs. La tragédie s’élargit car, quand on est victime de filicide psychique, le matricide psychique provient du surmoi cruel, avec l’objet primaire très endommagé et attaqué en permanence, ce qui entraîne une difficulté particulière à se protéger. Ainsi se produisent des expositions à des situations à risque, à des attaques contre soi-même, contre son propre corps, entraînant à son tour des attaques contre les talents, les opportunités, les possibilités de développement personnel et d’une vie plus épanouie.
La haine à la mère réelle est généralement immense et, ce qui est déconcertant, ce n’est pas ne pas être capable de retrouver l’objet, mais bien l’incapacité de se mettre à sa recherche. Privé d’une mère protectrice, le sujet se laisse aller à sa haine intérieure, privé de l’amour de la mère et de son amour pour elle. Des déroulements favorables ou pas dépendront de l’âge de l’enfant et du support de son entourage qui peut encore exister, un support qui reste généralement silencieux sur ce qui s’est passé, supprimant à l’enfant toute forme d’élaboration. Cependant, quel que soit son âge, l’enfant sera confronté à un complet désordre interne et à une immense colère, expression d’un appel à l’acceptation, à la compréhension, au partage et à la consolation.
L’enfant victime d’abus sexuel au sein de la famille et qui est dénié se sent victime d’une énorme injustice et ne se sentira plus jamais comme les autres enfants. La sexualité est entrée très tôt et perversement dans sa vie. Sa colère peut sembler incompréhensible à son milieu et même à son psychanalyste, s’il le cherche à l’âge adulte. Au fond, c’est contre sa mère qu’elle est dirigée, pour l’avoir dénié et pour l’avoir abandonné. Une telle reconnaissance prend souvent un long chemin, même de la part du psychanalyste.
Minerbo (2015) rapporte la cruauté du surmoi à des noyaux paranoïaques des parents et souligne qu’une telle analyse passe nécessairement par une théorie sur sa constitution: si dans l’une des acceptions freudiennes, il est l’héritier du complexe d’Œdipe, il en découle une autre qui résulte de l’identification du moi à l’ombre de l’objet, étant ainsi une instance qui a ses racines dans le ça et sa force dérivée de la pulsion de mort. Freud (1923/1976) le décrit comme sévère ou cruel. Minerbo souligne que ses caractéristiques sont psychotiques et qu’à la différence d’attaquer et de disqualifier le sujet pour quelque chose qu’il a fait, il le disqualifie, l’attaque et le détruit par ce qu’il est, ce qui implique une manœuvre perverse (Caillot, 2003). Il existe donc une rélation entre perversion narcissique, noyaux paranoïaques et surmoi cruel. L’auteur considère que les aspects non métabolisables de l’objet sont liés à son noyau paranoïaque, affirmation avec laquelle nous sommes tout à fait d’accord, seulement nous nous proposons de préciser en quoi ces aspects consistent dans le système paranoïaque, et, pour le faire, nous faisons recours à Racamier (1992).
Pour cet auteur, la notion de perversion narcissique se situe, d’une part, à la croisée des chemins entre l’intrapsychique et l’interactif, entre la pathologie narcissique individuelle et celle de la famille et, d’autre part, à la trajectoire entre psychose et perversion. À son avis, la paranoïa devrait être mieux placée en ce qui concerne la perversion narcissique, car celle-ci est son fleuron. Racamier souligne que c’est elle qui lui a montré les chemins sinueux mais puissants menant de l’angoisse dépressive (ou de sa menace) à la construction du système paranoïaque; c’est elle qui permet de manière flagrante la reconnaissance des voies menant de la psychose à la perversité.
Racamier soutient que la paranoïa doit être comprise comme un système qui correspond à un combat défensif contre deux types d’angoisse: la paranoïde, concernant la dissolution personnelle, la dilution de l’être, et l’angoisse dépressive liée au deuil et à la perte d’ objet. L’auteur résume cette situation en deux mots, affirmant que le système paranoïaque est à la fois antiparanoïde et antidépressif. Si, dans le premier cas, l’angoisse est plus rigide et froide, dans le second, elle se présente plus fluide et vibrante. À cela s’ajoutent des phénomènes de dépression expulsée qui, selon l’auteur, conduisent facilement, même irrésistiblement, à la paranoïa.
Le système paranoïaque, nous dit Racamier, se présente à l’état d’esquisses incomplètes et fugaces, de formations, qui sont manifestes, vives et labiles, entraînées par une dépression masquée, quoique oppressive, ou bien à l’état des organisations fixes, froides, fermes, rigides, durables, même indéracinables. Ces organisations penchent soit par la pente du délire, plus manifeste, réglé par le masochisme, soit par celle du caractère (italiques de l’auteur), plus insidieux, réglé par la haine. Dans le premier cas, se produisent plus de productions et, dans le second, des passages à l’acte. Un tel caractère est bien connu pour son orgueil, sa rigidité, sa méfiance.
Le système paranoïaque affecte de façon cohérente la relation et la pensée (italiques de l’auteur). L’objet est maintenu à une distance fixe en raison de la méfiance et de la peur de la perte de soi-même. Le paranoïaque se voit ainsi addict à la haine et au social (italiques de l’auteur). En ce qui concerne la pensée, l’inexact est éliminé, le fantasme évacué, le rêve effacé, régnant la logique impitoyable, même absurde, propulsée par le déni. Enfin, pour que le système paranoïaque atteigne sa fin, il faut qu’il soit érotisé, dit Racamier, et l’analité et le sadisme se présentent comme des engrais de domination et de torture. L’auteur considère que, entre perversion narcissique “simple” et caractère paranoïaque, la différence réside dans l’épaisseur et le poids des activités de déni: en renforçant cette partie de déni, la porte s’ouvre à la paranoïa.
Nous avons donc vu à quoi correspondent les aspects non métabolisés de l’objet en ce qui concerne les noyaux paranoïaques, aux versants délirants et caractériels, et comment ils entrent directement en relation avec la perversion narcissique: par la voie paranoïde, ces aspects impliquent des défenses contre l’angoisse de désêtre et, par celle du deuil, ils impliquent des défenses contre l’angoisse dépressive. Il est important de garder à l’esprit que, en ce qui concerne le caractère, l’organisation paranoïaque, rigide et réglée par la haine, tend des pièges par des manœuvres perverses visant à la domination-soumission et à atteindre un état psychique sans conflits. L’enfant victime d’abus sexuel au sein de sa famille est exposé à ce régime psychique et au modèle relationnel qui en résulte. Cet enfant représente une menace pour le narcissisme des parents. Disqualifié et attaqué en ce qu’il est, humilié et enragé, il sera exposé à la cruauté de son surmoi.
Perversions dans le transfert / contre-transfert
Lorsque la psychanalyse insiste sur l’élaboration du deuil comme mesure de la maturité émotionnelle résultante du développement psychique et qui concerne la condition du bébé de réaliser que ses sentiments ambivalents d’amour et de haine concernent une personne totale, elle le fait du point de vue intrapsychique. Ainsi, pour le bébé, il n’est plus question d’une “bonne” personne aimée ou d’une “mauvaise” personne haïe, à l’origine la mère qui nourrit et, par la suite, d’autres figures équivalentes et significatives pour l’enfant et pour l’adulte qu’il va devenir. Cette situation suscite la préoccupation pour l’objet à cause des dommages qui lui ont été causés par la haine – et de tels dommages peuvent continuer à se produire dans le monde interne du sujet tout au long de sa vie –, ce qui entraîne culpabilité et douleur. Le travail psychanalytique considère alors que, plus on reconnaît sa propre destructivité, plus on va pouvoir mobiliser des ressources réparatrices. La réparation des objets internes endommagés est considérée comme la source la plus importante de croissance psychique et de créativité.
Dans cette perspective intrapsychique, les fantasmes du sujet envers l’objet sont accentués et, même si l’on considère un millieu insuffisamment bon ou franchement insatisfaisant, c’est comme si l’objet réel ne comptait pas, étant toujours conçu comme découlant d’identifications projectives hostiles et destructives, chargées de haine qui lui ont été introduites. Il s’agirait alors des déformations provenantes du propre monde interne du sujet, mais lorsque nous considérons une perspective intersubjective, nous nous posons la question suivante: que se passe-t-il quand l’objet a été et reste encore vraiment haineux et destructif envers le sujet, de façon répétitive et de différentes manières au cours de son existence?
Enriquez (1993a) souligne les effets malins que le psychisme maladif d’une figure parentale psychotique a sur l’esprit d’un de ses enfants, du même sexe que lui ou elle. L’enfant se trouve empêtré dans des complots parentaux délirants à une époque de son développement pendant laquelle il dépend de ses parents et dispose de peu de ressources pour discriminer la compréhension du monde profondément perturbée qui lui est présentée par le parent malade. Dans un autre ouvrage, Enriquez (1993b) mentionne l’incidence du délire parental sur la progéniture, facteur de confusion et de dommages résultants de l’idéalisation et du déni, les pires ennemis, selon l’auteur, de la mémoire, du désir de recherche et de questionnement psychique.
Enquêter et interroger sont également compromis lorsque la réalité n’est ni totalement acceptée ni totalement déniée (Steiner, 1996). En traitant de la division du moi dans le processus de défense, Freud (1940 [1938] / 1975) montre comment, face à deux circonstances qui s’excluent mutuellement, il est possible de reconnaître et de nier simultanément la réalité de la castration par le déplacement et le clivage du moi, faisant coexister ainsi le désir et la réalité. Steiner commente que, bien que ce type de mécanisme ait été abordé pour la première fois dans les perversions et qu’il soit certainement très important dans ces conditions, il semble s’agir d’une réaction beaucoup plus générale face à une partie de la réalité difficile à accepter – telle celle concernant la violence et le trauma.
Il est difficile de faire face à la violence et au trauma et, en conséquence, un certain discrédit peut survenir chez l’analyste face aux analysants victimisés et traumatisés, en particulier en ce qui concerne l’abus sexuel au sein de la famille dans l’enfance, surtout quand il implique tout un domaine de la réalité qu’il trouve, en tant qu’analyste, inacceptable ou inconcevable. Cela favorise qu’il se retire vers un type de zone frontalière, où la réalité n’est ni complètement niée ni complètement acceptée. Dans ces circonstances, l’expérience de l’analysant se voit déreprésentée et déformée, ce qui aura des effets sur les déroulements de son analyse.
En se référant aux chemins possibles dans le travail de l’analyste avec le surmoi cruel, Minerbo (2015) souligne que des interprétations et des manœuvres doivent s’effectuer dans le champ transférentiel-contre-transférentiel, à partir de ce qui se passe entre analysant et analyste (italique de l’auteur). Dans cette perspective, précisément, l’analyste n’est pas seulement un écran de projection des questions intrapsychiques de l’analysant, puisqu’il participe, avec sa subjectivité, à la construction du champ psychanalytique qu’il partage avec l’analysant. Minerbo souligne que le transfert – auquel nous ajoutons l’évolution même du traitement – dépendra de la façon dont l’analyste va réagir.
La personne victime d’abus sexuel au sein de la famille dans son enfance sera particulièrement susceptible à n’importe quel doute sur la véracité de son expérience et toute intervention qui contredise les faits aura à nouveau un effet traumatique, augmentera les expériences d’humiliation et de haine, ainsi que la réaction thérapeutique négative, et cela favorisera des impasses assez douloureuses pour l’analysant dans le processus psychanalytique.
La tâche du psychanalyste est exigeante car ce que l’on observe le plus couramment dans le contre-transfert est l’humiliation et la haine. S’il soigne l’analysant dans le transfert en privilégiant la perspective intrapsychique, il évitera de tels sentiments, mais il refusera de considérer ce qui s’est passé avec l’analysant, car il comprend ses rapports comme résultants d’identifications projectives qui favorisent des situations imaginaires et des objets déformés. Il se passe alors une autre “confusion de langues”, cette fois-ci entre la théorie et la technique dans lesquelles l’analyste se trouve immergé et le rapport des faits tels qu’ils sont présentés par l’analysant.
Immergé dans son référentiel théorique, l’analyste ne voit pas l’analysant, mais plutôt la conception qu’il se fait de lui dans son esprit à partir du fondement qu’il privilégie, ce qui correspond ainsi à une perspective totalement narcissique. De cette manière, le désir d’investigation est conditionné et le questionnement psychique se limite, y compris celui du psychanalyste. Le cadre psychanalytique passe ainsi à couvrir ce qui devrait être révélé et reconnu (Bleger, 1967/1977) et il empêche l’analysant d’avoir une véritable expérience de partage, de manière à pouvoir se sentir compris en ce qui concerne la dimension de son vécu par rapport aux expériences violentes qu’il a réellement vécues, de sorte qu’il existe des conditions d’élaboration, aussi bien que de transformation et de dépassement, même s’il doit vivre avec ces souvenirs pour le restant de ses jours.
Une histoire racontée 50 ans plus tard
Ce n’est que « 50 ans plus tard » que l’artiste plasticienne française Niki de Saint Phalle, née en 1930 et décédée en 2002, décide de révéler son secret dans un livre intitulé Mon secret, écrit sous la forme d’une lettre à sa fille Laura. Saint Phalle dit qu’elle a d’abord écrit ce livre pour elle-même dans le but de se débarrasser du drame qui a joué un rôle aussi déterminant dans sa vie. Elle affirme être une personne qui a échappé à la mort et qui a ressenti le besoin de laisser parler la petite fille à l’intérieur d’elle. Elle dit que son texte est le cri désespéré de la petite fille (Morineau, 2014).
Saint Phalle décrit son père comme un homme idéaliste qui prônait une liberté raciale et religieuse absolue, un credo qu’elle a partagé tout au long de sa vie. Elle souligne que les choses ont commencé à se gâter lorsque ses seins ont commencé à se lever, ses hanches ont pris forme et elle est devenue l’objet du désir de son père d’exercer tout son pouvoir sur elle. Elle dit que tout son amour pour lui s’était transformé en haine et qu’elle avait le sentiment d’avoir été assassinée.
Elle raconte que son père a commencé à l’abuser à l’âge de 11 ans, quand il comptait 35 ans. Elle rapporte qu’un jour, soudainement, les mains de son père ont commencé à explorer son corps d’une façon tout à fait nouvelle pour elle. Elle s’est vue remplie d’angoisse, de plaisir et de peur. Son père lui disait de ne pas bouger et elle obéissait comme un automate. Puis, elle s’est débarrassée de lui avec violence et des coups de pied et elle a couru. Cependant, de nombreuses scènes de ce type se sont répétées à plusieurs reprises. Elle affirme qu’il avait sur elle le terrible pouvoir de l’adulte sur l’enfant. Elle pouvait se battre, mais il était plus fort. Son père, catholique fervent, devint pour elle un objet de haine; le monde lui montrait toute son hypocrisie. Elle concluait que tout ce qu’on lui enseignait était faux et qu’elle devait se reconstruire en dehors du contexte familial, au-delà de la société.
À l’âge de 20 ans, elle s’était tellement mordu la lèvre supérieure qu’une déformation s’était créée; un moyen, dit-elle, de mettre sa honte estampillée sur son visage. Elle va réacquérir un visage normal après avoir subi une intervention chirurgicale correctrice assez douloureuse, après quoi elle commence à attaquer d’autres parties de son corps pour donner libre cours à ses pulsions agressives. Alors des scarifications, des tentatives de suicide, des dépréciations personnelles se produisent, des signes d’appartenance à un monde hors de la loi (Raimbault, Ayoun et Massardier, 2005).
Elle avait l’habitude de porter dans son sac des couteaux de cuisine, des lames de rasoir et un petit revolver. Les fusils seront utilisés dans ses œuvres et elle se sentait vengée en tirant avec une arme réelle. Sur certaines toiles, elle mettait des sacs de peinture et elle tirait dessus comme si c’était son père, en vert, rouge, bleu et jaune. Elle se demandait, quand il la voyait le faire, s’il n’a jamais pensé que c’était sur lui qu’elle tirait.
Elle a subi une hospitalisation psychiatrique et dix électrochocs. Avant de recevoir son congé de l’hôpítal, elle a reçu une lettre de son père lui demandant si elle se souvenait que, à 11 ans, il avait tenté de la prendre comme maîtresse. Elle ne s’en souvenait pas, mais elle se souvenait d’un père élégant, qui cherchait à séduire les amies de sa mère et même les domestiques.
Lorsqu’elle a montré cette lettre à son psychiatre, il a allumé une allumette et l’a brûlée en lui disant que son père était fou, que rien ne s’était passé; qu’il inventait, que ce n’était pas possible. Un homme de son millieu et avec son éducation, religieux, il ne ferait pas une chose pareille. Elle commente que le médecin était père de famille, avec des filles de son âge ; il se refusait à croire au viol. C’était le point de vue de l’époque – une opinion qui persiste … Le psychiatre a écrit au père de sa patiente pour lui dire que, s’il continuait à lui envoyer des lettres, elle finirait ses jours dans un asile. Il lui a conseillé de se soigner, car il était victime de fantasmes dangereux.
À part son corps, ce sera sur ses œuvres qu’elle ira exprimer sa violence intérieure induite par l’inceste. Transportée sur l’œuvre, son agressivité a commencé à couler. Elle dit qu’en raison de la dépression, la descente dans la folie a été l’expérience la plus terrifiante de sa vie, marquée par de nombreux conflits et par le sentiment d’être menacée. Elle affirme que, de cette expérience de désintégration et d’obscurité, de toute cette saleté, de l’or germerait. Du chaos est venu l’ordre et, de l’hôpital psychiatrique, elle est sortie artiste.
Elle n’a jamais fait la paix avec son père et, après la mort de celui-ci, elle a filmé Daddy, ce qui lui a permis de libérer sa colère et ses fantasmes. Cependant, au lieu de l’apaiser, ce film a déclenché une dépression. Peu de temps après, sa mère lui a avoué tout savoir, son mari lui avait tout raconté et elle avait voulu se jeter par la fenêtre – mais elle ne l’a pas fait et n’a rien fait pour protéger sa fille.
La famille de Niki de Saint Phalle était très malade et dysfonctionnelle: un père incestueux, une mère non protectrice en collusion perverse avec lui, une fille sans défense. On peut considérer que des noyaux paranoïaques étaient en jeu dans le couple parental et la cruauté du surmoi avec laquelle on voit Saint Phalle est indéniable. Compte tenu de son comportement autodestructeur et de ses tentatives de suicide, on peut se demander ce que pensaient les professionnels qui l’assistaient. Quelle compréhension avaient-ils de leur comportement autodestructeur puisqu’ils ne connaissaient pas l’inceste? Quoi qu’il en soit, même quand il a fait surface, cela a été considéré comme impossible et mis au rebut.
La souffrance que Niki de Saint Phalle a subie a été atroce, avec des transgressions familiales et des situations récurrentes de violence surgissant de son intérieur, avec des attaques à son beau visage, en le déformant, à son corps harmonieux, scarifié, et à sa vie par des tentatives de suicide. En fait, elle a souvent échappé à la mort!
Dans un documentaire sur sa vie et son travail (2009), Niki de Saint Phalle affirme qu’elle a été très intelligente de ne rien avoir révélé à personne, car personne ne la croirait: “Mon silence était une stratégie de survie“.
Considérations finales
Dans l’assistance à des personnes victimes d’abus sexuel dans leur enfance, on peut argumenter que le traitement ne doit pas se limiter au fait abusif en soi, mais qu’il faut tenir compte de ce qui s’est passé auparavant. Cela nous semble évident, mais une telle considération sera inévitablement marquée par l’écoute que l’analyste va lui donner. Non seulement il doit tenir compte de ce qui peut être arrivé auparavant, mais il sera également fondamental qu’il considère le traitement qui a été donné après que le fait abusif a été connu : c’est là où se trouve le potentiel réel de la circonstance traumatique.
La violence sexuelle au sein de la famille envers des enfants révèle la grave maladie familiale et dénote l’insuffisance de ses soins et de sa protection. Ce sont des parents très malades psychiquement, articulés de façon complémentaire et réciproque lorsqu’aucune assistance ou protection n’est accordée à l’enfant après la révélation, ce qui a pour effet la continuité de la situation abusive en collusion parentale. L’enfant est disqualifié et se sent humilié, fomentant la colère, souvent masquée par des expériences dépressives et par la culpabilité.
La coexistence dans de telles familles implique depuis toujours, donc sans avant ni après, des minitraumas qui imprègnent la vie quotidienne de manière cumulative, par le biais de manœuvres perverses qui déforment la vérité, génèrent de la confusion et de l’angoisse, ainsi que des attaques sur le corps et sur l’intimité physique et psychique de l’enfant, expérimentées comme tentatives de filicide, puisqu’il s’agit des attaques à sa personne. Nous comprenons que l’enfant reste exposé au plaisir de souiller, de gâter, d’endommager sa personne, un tel plaisir directement lié à la domination et à l’assujettissement. C’est ainsi que le sujet pervers se trouve à l’abri d’un sentiment de nullité, d’un manque d’estime de soi (Caillot, 2003) – on dirait d’un manque à être, aux dépens d’un autre.
L’inceste, référé comme “meurtre psychique”, implique que la victime a des rapports à des objets internes “meurtriers” concernant des personnes qui ont attaqué son intégrité physique et sa vie psychique. En l’absence de reconnaissance de ce fait par le psychanalyste, il omet d’enquêter et de questionner, le non-savoir l’emporte, et la victime sera à nouveau exposée à la cruauté de son surmoi à partir des noyaux paranoïaques, non seulement de ses parents, mais aussi du psychanalyste.
Lorsque la préoccupation dépressive par rapport aux dégâts causés à l’autre n’est pas suffisamment développée chez les membres d’une famille réglée par la violence sexuelle intrafamiliale, en particulier en ce qui concerne les figures parentales, il y a le risque d’apparition de graves angoisses paranoïdes futures concernant la dissolution personnelle, la perte d’être. Le cycle des conflits transgénérationnels aura alors tendance à se répéter: noyaux paranoïaques chez les parents, surmoi cruel chez les enfants, sans qu’il y ait aucune transformation, aucune élaboration, aucun dépassement.
À notre avis, l’analysant victime d’abus sexuel durant son enfance ne devrait pas être traité comme un névrosé. Son histoire comporte d’innombrables subversions, issues d’une famille antœdipienne qui s’oppose farouchement au complexe d’Œdipe, qui ne tolère ni la vérité ni la différence, qui évite à tout prix l’altérité et la souffrance psychique inhérente à la croissance en soi. La vérité ne compte pas, les processus de pensée sont subvertis, restent compromis et, par conséquent, l’action et l’acte prévalent, ce qui fait que ces familles se caractérisent par le passage à l’acte, propre à une dynamique perverse, par le biais de manœuvres confusogènes, anxiogènes et de séduction mensongère.
Le passage à l’acte concerne à la fois l’évitement de l’élaboration psychique de questions telles que la séparation, la dépression, la dépendance, le sentiment d’insuffisance à propos de la tentative d’y trouver une solution magique. Cela nécessite d’une inscription dans la réalité externe, de valeur équivalente à celle de gestes et de mots magiques, destinés à obtenir des résultats tels que croire être immunisé aux conflits, croire à l’inversion générationnelle ou au faux comme vrai (Caillot, 2003). La séduction narcissique se voit éternisée et la scène primaire et la castration sont subverties.
Comme nous le voyons, ce sont des complications expressives dans l’histoire de la victime d’abus sexuel intrafamilial, à commencer par une famille, soit-elle incestueuse, soit-elle incestuelle, de toute façon violente et dérangeante, transgressive et perturbante. Dans une famille perverse, on vit dans deux mondes: celui de l’apparence et celui de la réalité, masquée et camouflée. Le clivage imprègne donc la vie à tout moment. Si l’on ne donne pas crédit à l’expérience de l’analysant, on répète l’expérience de cet analysant qui vit dans deux mondes, l’un dans lequel le psychanalyste croit qu’ils sont, y compris les progrès du processus psychanalytique, et l’autre, rendu inaccessible encore une fois, dans lequel l’analysant se trouve, se retrouvant une fois de plus dénié et au secret, puisqu’il est incompris. L’horreur se répète, la haine et le surmoi cruel sont réactivés. L’analyse est complètement pervertie.
Références
Bleger, J. (1977). Simbiose e ambiguidade. Rio de Janeiro: Francisco Alves. (Trabalho original publicado em 1967)
Caillot, J.-P. (2003). Les manœuvres perverses narcissiques. Groupal 12. Les perversions 1. Paris: Les Éditions du Collège de Psychanayse Groupale et Familiale, 71-95.
Minerbo, M. (2015). Contribuições para uma teoria sobre a constituição do supereu cruel. Revista Brasileira de Psicanálise, Vol. 49, n. 4, 73-89.
Morineau, C. (Org.) (2014). Niki de Saint Phalle. Barcelone: Ingoprint.
Phalle, N. S. (2009). Femme et artiste, Artracaille, 08/12/2009 (publicado em 10/03/2014). Disponível em: (https://www.youtube.com/watch?v=yrJ_HXh1_ws). Acesso em : 12/09/2017.
Racamier, P.-C. (1987). De la perversion narcissique. Gruppo 3. Perversité dans les familles. Paris: Clancier-Guénaud, 11-27.
Racamier, P.-C. (1989). Antoedipe et ses destins. Paris: Apsygée.
Racamier, P.-C. (1992). Le genie des origines. Psychanalyse et psychoses. Paris: Payot.
Racamier, P.-C. (1995). L’inceste et l’incestuel. Paris: Les Éditions du Collège.
Raimbault, G., Ayoun, P. & Massardier, L. (2005). Questions d’inceste. Paris: Odile Jacob.
Résumé
« La famille perverse et l’inceste : du filicide au matricide psychique. » Dans cet article l’auteure aborde des facteurs impliqués dans l’abus sexuel intrafamilial d’enfants et d’adolescents et plus particulièrement ceux qui sont liés à la dynamique psychique parentale. Consideré comme une problematique narcissique, plutôt que sexuelle, l’inceste est abordé sous l’angle de la perversion et de la perversion narcissique dans sa relation avec la paranoïa. Les effets de ce mode de fonctionnement psychique sont évoqués à la fois en ce qui concèrne la victime mais également en ce qui concerne le processus analytique engagé avec ces sujets et leurs familles.
Mots clés
Abus sexuels intrafamiliaux – Inceste – Perversion narcissique – Paranoïa – Cruauté.
Summary
“The perverse family and incest: from the psychological filicide to the psychological matricide.” Factors involved in domestic sexual abuse of children and adolescents related to parental psychodynamics are approached. By seeing incest as an essentially narcissistic issue rather than sexual, the author deals with perversion and narcissistic perversion in their relationship with paranoia and links them to the psychical pattern and relational model, to which the child or adolescent victim is subjected. Because of perverse aspects in the transference-countertransference, the consequences of this situation for his psyche and the particular constraints in the psychoanalytical treatment of these persons and their families are addressed. The story of Niki de Saint Phalle – told 50 years later – is presented.
Keywords
Domestic sexual abuse – Incest – Narcissistic perversion – Paranoia –Cruelty.
Resumen
“La familia perversa y el incesto: del filicidio al matricidio psíquico.” Se abordan factores implicados en el abuso sexual doméstico de niños y jóvenes relacionados con la psicodinámica de los padres. Concibiendo el incesto como una cuestión esencialmente narcisista, más que sexual, la autora discute la perversión y la perversión narcisista en su relación con la paranoia y las relaciona con sus psiquismos y el régimen relacional a los cuales el niño o adolescente víctima se ve sometido. Se refiere a las consecuencias de esta situación para su psique y las dificultades particulares en el tratamiento psicoanalítico de esas personas y sus familias debido a los aspectos perversos en la transferencia-contratransferencia. Se presenta una historia contada 50 años más tarde, la de Niki de Saint Phalle.
Palabras clave
Abuso
sexual doméstico – Incesto – Perversión narcisista – Paranoia – Crueldad.
[1] Une version complete de cet article intitulée « A mãe má: do filicídio ao matricídio psíquico” a été publiée dans la Revista Brasileira de Psicanálise, vol. 52, nº 4, 2018, p. 153-167.